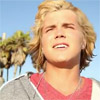ZEE, AMP, droit de la mer : petit guide pour comprendre les lois de l'océan
 Photo : ValeraRychman / Pixabay
Photo : ValeraRychman / PixabayPendant des siècles, la mer était considérée comme un espace libre. Les océans étaient alors réputés n'appartenir à personne et être ouverts à tous. Seule une zone allant jusqu'à environ 5,6 km des côtes (3 milles marins) pouvait être considérée comme souveraine pour un État côtier. L'exploitation ainsi que la navigation reposait alors essentiellement sur ce principe, le tout étayé de règles coutumières qui étaient loin de couvrir tous les enjeux majeurs, entre régulation du climat et commerce mondial, qu'allaient plus tard représenter les océans.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
La première tentative d'encadrement juridique de l'océan à une échelle mondiale a eu lieu en 1956, à Genève (Suisse) et a abouti à l'adoption, en 1958, de plusieurs conventions sur la mer, la haute mer, le plateau continental, la pêche ainsi que la conservation des ressources biologiques. Cette conférence constitue le premier jalon d'une série d'ateliers qui aboutiront à l'élaboration d'un traité international sur l'usage des espaces maritimes le 10 décembre 1982, lors de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de Montego Bay, en Jamaïque. Dans la pratique néanmoins, il n'entra en vigueur qu'en novembre 1994.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, parfois aussi appelée "Convention sur le droit de la mer de Montego Bay", établit un cadre juridique international, fondé sur des règles de bonnes conduites ainsi que sur des principes précis : souveraineté des États sur certaines zones, liberté de circulation, partage des ressources et protection du milieu marin. Elle vise également à favoriser :
- la protection et la préservation du milieu marin ;
- la conservation et l'utilisation durable des ressources marines ;
- la communication internationale et la promotion de la paix ;
- la recherche scientifique marine.
La Convention sur le droit de la mer de Montego Bay est également à l'origine du Tribunal international du droit de la mer, une autorité judiciaire apte à juger les différents « relatifs au droit de la mer » ainsi qu'à trancher sur toute interprétation du contenu de la convention.
Aujourd'hui, véritable constitution des océans, ce traité rassemble 157 États signataires. On n'y trouve toutefois pas tous les pays du monde, comme les pays enclavés bien sûr, mais aussi la Turquie, le Venezuela, Israël ou encore les États-Unis qui ont fait le choix de ne pas la ratifier.
La zone économique exclusive
Une zone économique exclusive (ZEE) est une zone maritime dans laquelle s'exerce de plein droit la juridiction économique d'un État côtier. Ce dernier y possède la primauté des intérêts tout en ayant l'exclusivité de l'exploitation, de l'exploration, de la gestion des ressources (vivantes ou non) ainsi que de leur préservation. En complément, l'État en question a aussi l'obligation de porter secours à tout bâtiment ou personne en détresse se trouvant dans ces eaux et d'y assurer une libre circulation, aussi bien sur l'eau que dans les airs (sauf en cas de menace sécuritaire).
L'exclusivité économique d'un pays sur ses ZEE vaut évidemment pour tout ce qui y flotte, mais pas seulement. Elle s'applique également pour ce qui se trouve entre deux eaux, sur le plancher océanique (comme les nodules polymétalliques qui sont, aujourd'hui, dans le collimateur des fabricants de batteries de voiture), et même dans le sous-sol sous-marin.
Concrètement une ZEE s'étend en mer jusqu'à 200 milles marins à partir des lignes de base d'un État côtier, une distance qui équivaut à environ 370,4 kilomètres.

Les eaux territoriales, une zone de plein droit
La notion d'eau territoriale diffère de celle de ZEE. Là où la ZEE touche à l'exclusivité économique d'un État côtier, les eaux territoriales (ou mer territoriale) impliquent sa souveraineté totale. En d'autres termes, l'État y a pleine compétence et sa législation ainsi que ses réglementations s'y appliquent pleinement au même titre que sur son territoire terrestre.
Les eaux territoriales couvrent une zone de 12 milles marins au large depuis les lignes de base, ce qui représente environ 22,2 km. Le passage en eau territoriale d'un pays est autorisé sous réserve qu'aucune intention agressive n'est décelée.
La zone contiguë, extension des compétences d'un État
La zone contiguë commence là où se termine la mer territoriale et court sur une bande épaisse de 12 milles marins. Il s'agit d'une zone dans laquelle l'État côtier peut exercer un contrôle limité afin de prévenir ou de réprimer certains types d'infractions (douane, fiscalité, immigration et santé publique seulement). La police de l'État y a alors un droit de poursuite et d'arrestation.
Dans une zone contiguë, la navigation est libre sans condition, même si elle peut être surveillée.
Les eaux internationales ou la mer libre
Les eaux internationales commencent là où se termine la ZEE d'un pays. Également appelé "haute mer", il s'agit d'un espace commun à tous, rejoignant la notion d'espace libre évoquée en introduction, et ne souffre de l'autorité d'aucun État. On y jouit donc d'une liberté de navigation et de survol totale et sans entrave, garantie par le droit international. Il en va de même pour la pose de câbles et pipelines sous-marins, mais aussi, et c'est assez étonnant, de la création d'îles artificielles.
Quant aux ressources qui s'y trouvent, elles sont, en principe, exploitées suivant des règles collectives et tombent sous le coup des diverses conventions. Les eaux internationales représentent approximativement 60 % de la surface des océans.

Des aires marines protégées pour aider les océans
Instituées lors du Sommet de la Terre de 1992 à Rio (Brésil), les aires marines protégées (AMP) sont des zones délimitées visant à protéger les écosystèmes marins, à préserver la biodiversité et à assurer une gestion durable des ressources naturelles. Certaines AMP peuvent également être créées pour sauvegarder un patrimoine culturel, améliorer ou préserver la qualité des eaux, mettre en avant le développement ou l'exploitation durable, ou encore sauvegarder un atout, qu'il soit économique, scientifique, social, etc.
Les activités industrielles sont soit interdites, soit fortement restreintes dans une AMP. Les bateaux de pêche de moins de 12 mètres de long y sont cependant tolérés à condition qu'ils n'utilisent que des filets dormants et non des chaluts traînants comme ceux adoptés dans la surpêche. Il arrive également que seules les activités à faible impact soient acceptées dans l'AMP (plongée, pêche à la ligne, pêche coutumière, etc). Dans ce cas, on parle d'AMP stricte.
Une AMP peut être établie dans n'importe quelle zone, y compris en haute mer. La création d'une AMP est souvent motivée par la nécessité de préserver des habitats critiques, de protéger des espèces menacées ou de restaurer des écosystèmes dégradés. Elles jouent un rôle crucial dans la résilience des océans face aux pressions anthropiques et aux changements climatiques. Malheureusement, l'absence de réels moyens de coercition fait que, dans la pratique, ces zones ne sont que rarement respectées.
En 2023, le monde comptait 18 000 AMP pour approximativement 30 millions de km² d'océan sanctuarisé. Cela représente 8,2 % de la surface des mers et des océans.